Mis à jour le 10.10.2023

Simple ? Oui ! Bien-sûr que c'est simple de développer le sens de l'écoute, cette faculté qui optimise les informations et les interactions. Clé de voûte de l'intelligence collective, telle que démontrée de façon évidente par le jeu et le travail musical, cette aptitude est tout aussi intéressante à décrypter dans les dynamiques non-humaines. Car, là aussi, elle crée la cohésion des groupes, sa vitalité préservant la survie des espèces par des articulations telles que l'entraide, la symbiose et la coopération. L'écoute est donc essentielle à l'équilibre des écosystèmes et ce, dans toutes les échelles du vivant, du langage humain au monde animal, végétal ou minéral. Oui, quand bien même infinitésimale, cette clé majeure de créativité peut optimiser les interactions.
Au cœur du collectif créatif
Preuves à l'appui, la nature montre l'importance de l'écoute, attestant que ce principe est source de survie et de
pérennité. Alors dans les rapports humains, notamment professionnels, comment faire pencher la balance en ce sens, pour faciliter les processus de régénération ? Autrement dit, quelle écoute peut
répondre à ce besoin fondamental, à la fois d'un point de vue écologique, social et solidaire ? Et comment
l'articuler au quotidien pour préserver les potentiels humains et non-humains ?
À l'évidence, ce questionnement nécessite de mettre en relief un aspect fondamental de la dynamique des langages, un aspect essentiel à toute communication, hors la perception visuelle, aujourd'hui sollicitée à l'extrême. Alors, au risque d'enfoncer des portes ouvertes, c'est cet aspect qui sera abordé conséquemment ici. Parce qu'à l'évidence, le vivant ne peut s'en extraire sans prendre le risque de creuser tous les écarts à l'extrême et d'encourir les effets les plus délétères. Cet aspect donc, fondamental de la dynamique des langage dans ce qu'ils ont de plus subtile, est celui de la perception auditive, interindividuelle et environnementale. Et celui-ci est d'autant plus important qu'il permet, justement, d'affiner la pensée, d'optimiser la perception des besoins réels, qui ne peuvent d'ailleurs s'affiner qu'aux travers de temporalités et de spatialités précises. Simplement parce que les rythmes vitaux, cérébraux, "parlent" bien plus du réel dans ces nuances qu'il n'y paraît.
En effet, parlant ici de la notion d'interaction dans ses articulations les plus fines, il devient nécessaire l'investir de manière significative et proactive, précisément pour construire du sens environnemental, donc en favorisant une bonne coordination écologique. Cela d'autant plus en regard des phénomènes d'instantanéité, d'improvisation ou d'impondérable qui s'y articulent, phénomènes au cœur desquels se trouve les perceptions sensori-motrices et plus particulièrement la perception auditive. Parce que d'elle dépend ce qui s'imprime, ou pas, et a fortiori, ce qui s'exprime en termes de rythmes de vie, d'impact environnemental. Alors telle est la raison pour laquelle l'enjeu écologique est posé ici de manière à revisiter cette faculté, afin de pouvoir optimiser les capacités d'imagination pour les conditions de travail. Car, ce dont il est question au fond, c'est de notre rapport au réel. Aussi le langage musical peut-il apporter sa pierre pédagogique à l'édifice écologique, autant en termes de survie collective que de vitalité collective, fournissant ainsi une aide précieuse en termes de coordination. Alors attardons-nous y un instant.
Pour savoir comment renforcer cette faculté, d'une part. Et pour savoir en quoi elle peut ouvrir les perspectives, d'autre part. C'est pourquoi nous chercherons à appréhender cette problématique à sa juste mesure, ce pour lequel il est nécessaire de la rattacher aux modalités de développement des compétences. Alors à cet égard, il sera question de la considérer à partir de critères cohésifs tels qu'ils s'activent dans le rapport musical, soit, par des articulations fines et nuancées. Et ce rapport est d'autant plus intéressant qu'il facilite la perception de ressources régénérantes, en lien avec les rythmes de la nature, tels qu'illustrés précédemment dans les grandes lignes. Un rapport donc, qui peut rééquilibrer la tendance selon laquelle la communication environnementale doit être plus utilitariste que coopérative. Aussi, telle est notre proposition : revisiter cette dimension essentielle à la préservation des potentiels humains et naturels, à leur interdépendance, en offrant une voie facilitatrice où l'évolution professionnelle peut s'appuyer sur des critères interactionnels solides, une logique écosystémique.
S'ouvre ainsi la possibilité d'appréhender cette faculté sous ses nombreuses facettes. Pour les plus importantes : donner un sens profond au travail, libérer une créativité sereine, activer des synergies restauratrices de façon constante, régulière. Et cela, quand bien même il existe des formes professionnelles déjà validées dont, parmi les plus plébiscitées, l'écoute active ou l'écoute sélective. Car celles-ci n'ont pas vraiment prouvé leur efficacité environnementale, leur vocation étant avant tout individualistes et leurs codifications n'intégrant pas, à l'évidence, les infinies ressources collectives nécessaires à la vitalité des écosystèmes. Il en résulte alors un sens de l'écoute amoindri, voire inhibé dans sa fonction écologique fondamentale. Or, plus nous le limitons dans les situations quotidiennes, plus les processus de décision et d'action s'accélèrent, opérant par contrepoids la perte de ressources vitales, créatrices. C'est alors que ces précipitations creusent les écarts avec le vivant dans son ensemble, jusqu'à réduire à peau de chagrin la vitalité sociale. En conséquence, comment réhabiliter cette faculté qui a pourtant vocation à ouvrir les perspectives ? Un langage peut y aider, par sa nature multi-dimensionnelle et contextuelle.
L'écoute musicale, en effet, peut servir allègrement cette cause. Parlons-nous de musicothérapie ? À vrai dire, bien qu'il
y ait des similitudes, la démarche ici est différente. Car ce processus artistique tient aussi compte des facteurs d'improvisation. Alors en
connaissant et développant cet art, il devient possible de renouveler le rapport au temps, à l'espace et par là, de
libérer des ressources régénérantes. L'écoute devient ainsi une interface constante qui, en tout temps, ravive les
rythmes, et en tout lieu, ravive les musicalités, ces critères de créativité qui sont comme les faces d'une même pièce. C'est pourquoi l'écoute est essentielle à l'équilibre des écosystèmes, étant cette clé signifiante et significative qui permet de développer du sens commun, à l'image du principe de régénération cellulaire par lequel
la Vie se diffuse en continu, avec sens et attention.
Prendre en main cette clé donc, savoir comment l'utiliser face aux enjeux écologiques, nécessite de bien la connaître, de s'entraîner à l'identifier, afin qu'elle soit consistante en toute circonstance et permette au potentiel créatif à se régénérer. C'est alors qu'en développant cette connaissance spécifique, émergent constamment par des éléments de langage qui portent du sens environnemental. Simplement, parce qu'ils rendent audibles l'énergie vitale et attestent de son authenticité. De fait, ce rapport auditif fait de l'énergie vitale un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, soit, un socle immuable et sans frontières. Cela revient à dire que cette dimension vibratoire de l'audible est un facteur important pour activer et préserver les processus de régénération. Aussi, tel est l'objet de notre méthode de créativité : aider à mieux connaître cette clé, sa richesse, savoir l'appréhender au quotidien dans toutes ses ressources créatrices, afin de développer des compétences transversales et compétences vertes qui donnent au travail toute sa saveur, toute sa valeur.
En outre, d'un point de vue individuel, cette approche a ceci de stimulant : c'est qu'elle renforce le potentiel créatif dans sa globalité. En effet, explorer la dimension audible de l'énergie vitale ouvre à une plénitude intérieure qui permet de s'extraire des nuisances sonores et par là, de réduire toute charge mentale contre-productive. Il suffit d'en connaître la délicatesse. Il suffit de savoir questionner cet art dans ses capacités d'harmonisation, de l'organique à l'organisé. Il suffit donc de savoir la mobiliser en tant que source d'équilibre, afin de pouvoir évoluer plus sereinement face à l'ampleur et la complication des enjeux environnementaux, ce défi sans précédent qui appelle une exploration proportionnelle du champ de l'audible. Autrement dit, le jeu en vaut la chandelle. Oui vraiment, il vaut la peine de se poser pour affûter cette perception dans ses nuances infimes car, sans qu'il n'y paraisse de prime abord, sa carence a des effets délétères sur toutes les échelles du vivant.
Alors, haut les cœurs ! Puisque l'écoute musicale peut encore renouveler les perspectives par ses circonvolutions attentives et attentionnées. Puisqu'en revisitant nos environnements sonores, il est encore possible d'y déceler des nuances sublimes qui ravivent le sens de la coopération, à l'image de tout travail musical. Et puisqu'en nous reliant ainsi à la nature, il y a encore matière à libérer du sens commun. Par conséquent, telle est la démarche artistique, réjouissante, qui s'offre ici. Tout comme on explore la perception visuelle dans les arts appliqués, les arts plastiques et l'architecture à l'aide de nuanciers de couleurs, de formes et de textures. En d'autres termes, de même que les nuances graphiques servent l'esthétique, de même les nuances sonores peuvent servir les rythmes vitaux. Alors, maintenant que la question des nuances est clarifiée, il n'y a plus qu'à !... Oui, il n'y a plus qu'à explorer ce qui peut encore ouvrir les axes de créativité pour la cause environnementale. Il n'y a plus qu'à prendre appui sur la fonction écologique de la perception auditive pour revisiter la culture de proximité, afin de faciliter le développement des compétences transversales et vertes nécessaire à la préservation de l'environnement.
Mais pour ce faire, il faut encore souligner un point fondamental duquel dépend l'ouverture des perspectives et par là, la capacité à s'investir pour l'équilibre des écosystèmes. Ce point concerne la valorisation du sens de l'ouïe dans le partage de connaissances. En effet, dans la mesure où le sens visuel est généralement priorisé sur celui-ci, surtout d'un point de vue stratégique, soit par habitude, soit par des codes culturels conditionnés et arbitraires, les ressources auditives tendent, en revanche, à être inhibées. Or celles-ci sont bien plus porteuses de sens écologique qu'il n'y paraît, et qui plus est, d'un sens qui permet de trouver sa voie durablement. C'est pourquoi l'écoute musicale est d'une aide précieuse pour réhabiliter cette faculté dans sa plénitude. De plus, celle-ci allant là où les mots trouvent leur limite, il devient possible de trouver de nouvelles articulations utiles à cette cause. Aussi les dynamiques individuelles et collectives peuvent-elles y trouver du sang neuf, c'est-à-dire des ressources qui leur permettent de mieux s'articuler autour de cet enjeu, levant les freins à l'initiative écologique.
Synthétisons cette idée : en quoi le fait d'optimiser la perception auditive est-il facteur de cohésion sociale et sociétale ? Ça l'est tandis que les besoins de recherche et d'expérimentation trouvent ainsi leur juste expression à savoir : une latitude qui oxygène les dynamiques, active des processus de régénération et au fond, enrichit la communication quotidienne. Toutefois, comment s'assurer de ce critère qualitatif sur le long terme ? Qu'est-ce qui garantit sa stabilité, voire sa pérennité ? Pour l'observer, rien de plus simple : il suffit de se référer au jeu musical des ensembles harmoniques où il se manifeste à foison. Oui, il suffit de s'immerger dans cet univers d'efficience pour appréhender ses articulations, si essentielles aux écosystèmes.
En d'autres termes et pour conclure, l'écoute musicale est une clé de créativité autant que d'équilibre. Elle n'est donc ni accessoire, ni anecdotique. Et encore moins dans les échanges linguistiques où elle produit des sauts qualitatifs. Assurément, c'est là qu'elle est encore plus enrichissante et stimulante, tandis qu'en émerge une vitalité cohésive, oui, dans l'entrelacs de l'intercompréhension ou du plurilinguisme. Aussi l'opportunité est-elle toute trouvée d'explorer cette clé et ses ressources, tellement porteuses d'humanité et de vitalité, donc de pérennité, afin que se libèrent des processus qui nourrissent le sens de la Vie, face à la montée des instabilités où celui-ci s'effrite et se morcelle. C'est pourquoi l'enjeu de l'écoute est forcément holistique. Car ainsi il devient possible de trouver les repères sonores d'un vivre ensemble sensé, désirable et soutenable, où s'articulent de salutaires dynamiques d'apaisement autour du commun. Alors, telle est la raison d'être de notre proposition. Tel est l'objet de notre apport créatif, cette petite pierre à l'édifice de la cause environnementale dédiée autant au langage analytique que symbolique, afin que ces deux formes puissent encore se renouveler, s'alterner, se compléter, se synchroniser ou s'intriquer, simplement en vue d'un regain de l'énergie vitale dans la richesse de ses processus et phénomènes.
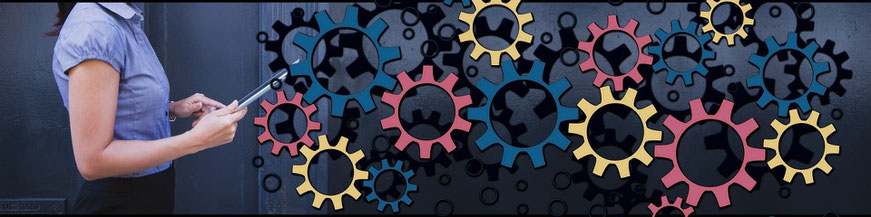
Il y a donc fort à parier que cette démarche questionne, aujourd'hui comme jamais, les rythmes de travail. Observons : qu'advient l'écoute lorsque s'enchaînent nos actions machinales, les cadences machiniques et mécaniques liées à la seule focalisation visuelle ? Oui, qu'advient-elle dans les langages mimétiques et ceux, plus ou moins coercitifs, polarisés sur la surface du réel, qu'ils soient conformistes ou anticonformistes et quel que soient leurs exigences respectives, pour ne pas dire leurs intransigeances ? Cette impasse questionne alors la validité de ces mécanismes, liés à une tendance qui standardise les espaces et les temps de travail, réduisant l'art de communiquer, ses ressources régénérantes. Certes, l'impasse interroge l'intérêt de ce fonctionnement sociétal tandis que s'y concentrent - de plus en plus outre mesure - des instincts de prédation, au détriment des besoins de vitalité et de coopération. Alors telle est la raison d'être de cette proposition, portée par l'espoir d'un renouveau, d'une perspective où l'art de communiquer gagne en fluidité, sans rapport avec ce qui réduit le travail à la poursuite d'une quête insaisissable, tantôt multitâche, âcre et terne, tantôt insatiable. Telle, finalement, la poursuite du vent.
Et si, au lieu d'une poursuite, il y avait avant tout de bonnes raisons et d'infinies possibilités de se poser au quotidien ? De celles qui nourrissent le dialogue social. De celles qui libèrent le dialogue des cœurs, souvent plus proches qu'il n'y paraît et pourtant, si peu reliés. Surtout professionnellement. Qu'en dites-vous ? Et si, chacun, chacune, nous trouvions dans l'écoute musicale, l'inspire et l'expire qui tempère nos courses échevelées, l'agilité d'une attention mutuelle ? Oui, là où la musique permet à chacun, chacune de trouver sa voiX et sa voiE, en explorant l'infime et l'incommensurable de son langage.
Kittery Abidos
Artiste consultante, ingénieure pédagogique
Conception musicale et graphique
Spécialisée en écologie sonore











Écrire commentaire